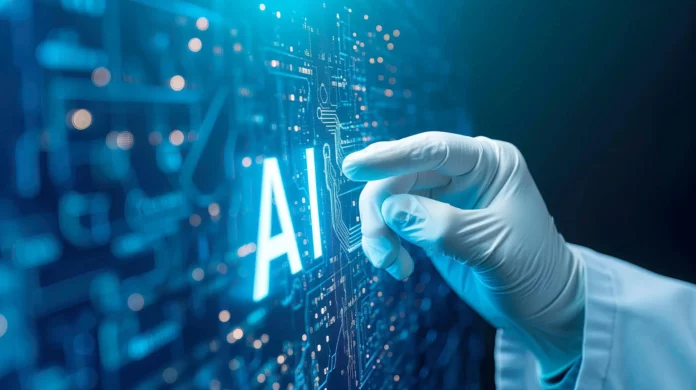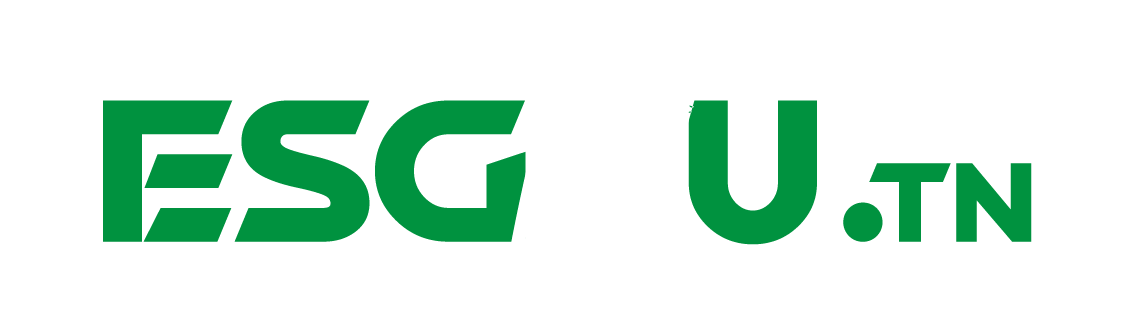Une étude récente et inédite de l’association GreenIT révèle l’impact environnemental considérable du numérique à l’échelle mondiale, et plus particulièrement celui de l’intelligence artificielle (IA). Cette analyse soulève une question cruciale : l’essor fulgurant de l’IA est-il compatible avec les impératifs environnementaux de notre époque ?
Une évaluation précise et préoccupante de l’impact de l’IA
Le rapport de GreenIT chiffre avec précision l’empreinte écologique du numérique, en mettant en lumière le rôle prépondérant des infrastructures dédiées à l’IA. Le numérique, dans son ensemble, est responsable de l’émission de 1,8 milliard de tonnes d’équivalent CO2, un chiffre stupéfiant qui dépasse à lui seul l’empreinte carbone de pays entiers comme la France (5,5 fois), le Canada (2 fois) ou la Tanzanie (100 fois).
Dans ce contexte, les serveurs spécifiquement dédiés à l’intelligence artificielle représentent déjà 4 % de ces émissions globales. Cette proportion, bien que pouvant paraître modeste, est équivalente à l’empreinte carbone d’un pays comme le Chili. Plus alarmant encore, elle surpasse l’empreinte carbone combinée de tous les ordinateurs portables en circulation dans le monde.
Ces chiffres, basés sur des données de 2023, pourraient même sous-estimer l’impact réel de l’IA. L’année 2023 a été marquée par le lancement de ChatGPT, et l’essor de l’IA générative s’accélère de manière exponentielle. Il est donc fort probable que l’empreinte environnementale de l’IA ait connu une croissance significative depuis lors.
Une empreinte carbone en forte croissance et des effets secondaires sous-estimés
L’étude de GreenIT met en garde contre l’augmentation rapide et préoccupante des impacts liés aux serveurs dédiés à l’IA. « Au regard des projections de croissance à venir des usages des technologies IA, la proportion des impacts des serveurs IA est amenée à s’accroître encore plus rapidement dans les prochaines années, avec les conséquences environnementales correspondantes », alerte le rapport.
Outre les émissions de gaz à effet de serre, la généralisation de l’IA engendre une consommation accrue de ressources naturelles. L’extraction de minéraux et de métaux rares, l’utilisation intensive de ressources abiotiques et la production de particules fines sont autant de problématiques environnementales qui accompagnent le développement de ces technologies.
Les infrastructures informatiques dédiées à l’IA sont particulièrement énergivores. Les serveurs configurés pour l’intelligence artificielle consomment à eux seuls plus de 18 % de l’électricité de l’ensemble des centres de données, alors qu’ils ne représentent que 2 % du nombre total de serveurs. Cette disparité s’explique par l’utilisation de puces spécialisées et de GPU extrêmement gourmands en énergie, notamment lors de la phase d’entraînement des modèles d’IA, un processus nécessitant des capacités de calcul considérables.
Contrairement à une idée reçue, l’intelligence artificielle ne se substitue pas aux usages préexistants, mais vient s’y ajouter. L’essor de l’IA générative entraîne une demande supplémentaire en ressources informatiques, ce qui se traduit par la nécessité de mettre en place de nouveaux serveurs au lieu de réutiliser les infrastructures existantes.
Au-delà de l’impact direct de la construction et de l’exploitation des serveurs, l’IA génère également des effets secondaires qui sont souvent sous-estimés. Comme le souligne l’étude de GreenIT, ces estimations ne prennent pas en compte les équipements supplémentaires qui seront vendus sous l’argument marketing de l’intelligence artificielle. Ce phénomène pourrait amplifier davantage l’empreinte environnementale du secteur technologique.
Vers une nécessaire réflexion sur les usages et une sobriété numérique
Face à ces constats alarmants, GreenIT insiste sur la nécessité d’une régulation plus stricte des usages de l’IA. L’Agence de la transition écologique (Ademe) partage ce point de vue, appelant à une « sobriété numérique ». Il devient impératif de hiérarchiser les applications de l’intelligence artificielle : doit-on mobiliser autant de ressources pour des avancées scientifiques et médicales, ou pour des usages plus futiles, comme le choix d’une paire de chaussures ?
Selon l’Agence internationale de l’énergie, la consommation des centres de données pourrait doubler d’ici à 2026, en grande partie sous l’effet combiné des cryptomonnaies et de l’intelligence artificielle. Malgré ces mises en garde, les investissements colossaux dans ce domaine se poursuivent. Avec un projet Stargate estimé à 500 milliards de dollars aux États-Unis et une enveloppe de 109 milliards prévue en France, la tendance ne semble pas prête de s’inverser.
Une prise de conscience collective s’impose pour limiter l’impact écologique de cette révolution technologique. Il est essentiel de repenser nos usages de l’IA et de privilégier une approche responsable et durable.