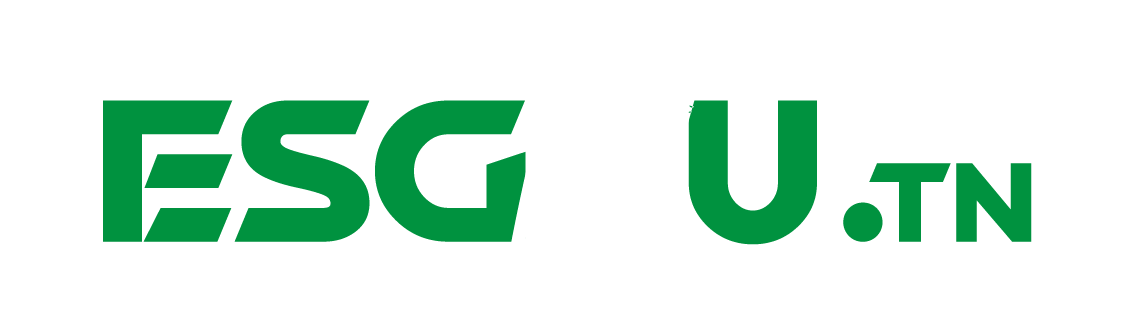La lutte contre le changement climatique repose principalement sur la réduction de l’utilisation des énergies fossiles. Cependant, cette « défossilisation » de l’économie pourrait entraîner un effet paradoxal à court terme : un risque de surchauffe climatique transitoire. En cause, la disparition progressive d’un puissant agent refroidissant, le dioxyde de soufre (SO₂), émis lors de la combustion des énergies fossiles. Pour faire face à ce déséquilibre temporaire, une solution efficace et immédiatement mobilisable existe : réduire les émissions de méthane, notamment celles issues de l’agriculture.
Le paradoxe de la défossilisation : un réchauffement temporaire inattendu
La combustion des combustibles fossiles – charbon, pétrole, gaz naturel – émet du dioxyde de carbone (CO₂), principal responsable de l’effet de serre et du réchauffement climatique. Mais cette même combustion libère aussi du dioxyde de soufre, un gaz dont l’effet est inverse : il refroidit la planète en générant des aérosols réfléchissant les rayonnements solaires. Ces particules agissent à trois niveaux : directement via le SO₂, indirectement par les aérosols formés, et en renforçant l’albédo des nuages, les rendant plus brillants et plus réfléchissants.
Or, si l’on réduit rapidement les émissions de SO₂ sans pouvoir compenser immédiatement les effets du CO₂, cela pourrait provoquer une élévation soudaine des températures. Les rapports du GIEC estiment que cette « surchauffe transitoire » pourrait atteindre entre 0,11 °C et 0,68 °C après un arrêt rapide des énergies fossiles. D’autant plus que l’effet refroidissant du SO₂ disparaît quasi instantanément : sa durée de vie dans l’atmosphère varie de quelques jours à quelques semaines, contre plusieurs décennies pour le CO₂.
Le méthane, un levier efficace à moyen terme
Face à cette asymétrie temporelle, il devient crucial de trouver un levier climatique capable de produire des effets rapides. C’est ici que le méthane entre en jeu. Bien que moins abondant que le CO₂, le méthane (CH₄) est responsable d’un réchauffement estimé entre 0,3 °C et 0,8 °C. Sa durée de vie médiane dans l’atmosphère est d’environ dix ans, ce qui en fait un gaz à effet de serre dont la réduction offre un bénéfice climatique relativement rapide.
Contrairement à certaines solutions de géo-ingénierie encore expérimentales et potentiellement risquées, la réduction des émissions anthropiques de méthane est une solution immédiate, techniquement accessible et sans effets collatéraux majeurs. Mais elle suppose une volonté politique forte et une mobilisation coordonnée, en particulier dans le secteur agricole.
Agriculture : un secteur clé à transformer
Aujourd’hui souvent perçue comme source de problèmes écologiques et sanitaires, l’agriculture pourrait devenir un acteur central de la lutte climatique. Environ 40 % des émissions anthropiques de méthane proviennent du secteur agricole, principalement de l’élevage de ruminants et des rizières inondées. À cela s’ajoutent 35 % liés à l’exploitation des énergies fossiles (dont une partie disparaîtra avec la défossilisation) et 20 % issus de la gestion des déchets (décharges, traitement des eaux, fumiers…).
Il devient donc stratégique de cibler l’agriculture pour réduire les émissions de méthane, par des approches technologiques et des changements de pratiques. Il est par exemple possible d’agir sur :
- L’alimentation des ruminants pour limiter leur production de méthane.
- Le choix de races bovines moins émettrices.
- L’amélioration des techniques de culture du riz.
- La récupération du biogaz issu des fumiers.
Cependant, ces solutions techniques, encore en cours de développement à grande échelle, nécessitent innovation, financement, et surtout appropriation locale par les agriculteurs.
Changement des régimes alimentaires et rôle des consommateurs
Une réduction substantielle des émissions de méthane ne pourra être atteinte sans repenser nos modes de consommation. Réduire la consommation de viande de ruminants, de produits laitiers ou encore de riz apparaît comme une mesure efficace. Cela implique toutefois des changements de comportement profonds et une prise de conscience collective des enjeux climatiques.
Ce type de transition requiert des politiques publiques ambitieuses, associées à des campagnes de sensibilisation et à un accompagnement ciblé des acteurs du monde agricole. L’adhésion des citoyens et des producteurs est essentielle pour éviter les blocages sociaux et assurer une mise en œuvre équitable.
Des initiatives locales aux stratégies globales : le rôle des GREC
La territorialisation des réponses peut jouer un rôle déterminant. Les GREC (Groupes Régionaux d’Experts sur le Climat) pourraient constituer un levier précieux. Ces structures hybrides, mêlant expertise scientifique et savoirs locaux, peuvent faciliter la co-construction de solutions adaptées aux spécificités locales, à travers des démarches de recherche-action-participative (RAP).
En encourageant les échanges entre scientifiques, agriculteurs, citoyens et acteurs économiques, les GREC peuvent initier des expérimentations concrètes : fermes pilotes, ateliers de recherche collaborative, espaces de dialogue technique, etc. En s’appuyant sur des dispositifs tels que les boutiques des sciences, les tiers-lieux de recherche, les fablabs ou les hackerspaces, ils pourraient accélérer l’innovation sociale et technologique.
Une stratégie à double échelle : locale et internationale
En créant un réseau international de GREC, il serait possible d’articuler actions locales et politiques globales. Ces dynamiques ascendantes, portées « par le bas », viendraient enrichir les stratégies nationales et internationales, souvent dictées par une vision descendante. Elles pourraient ainsi renouveler les approches en matière de gouvernance climatique et contribuer à l’émergence d’une agriculture durable, sobre en méthane et résiliente face aux défis du XXIe siècle.