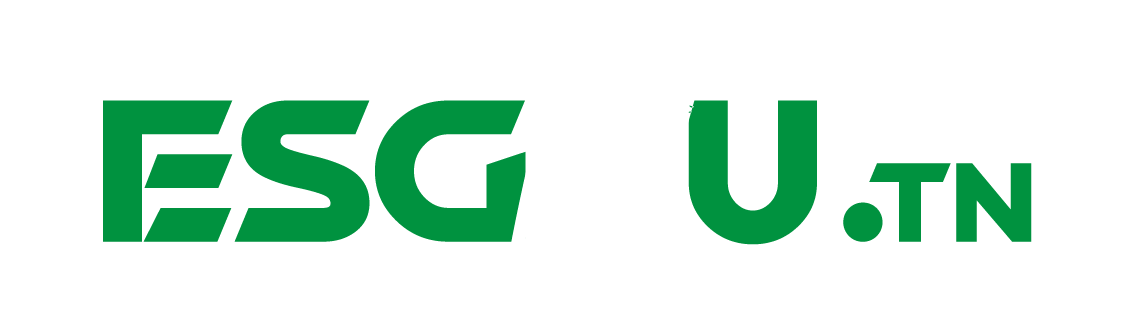Le paquet de mesures ambitieux adopté par l’Union européenne pour lutter contre le réchauffement climatique, connu sous le nom de Pacte Vert Européen, est aujourd’hui confronté à une vague de critiques virulentes. Des acteurs issus du patronat et de l’extrême droite, partageant une vision similaire à celle prônée par un ancien dirigeant américain en matière de dérégulation, remettent en cause la viabilité de ce projet crucial pour l’avenir de la planète.
Un Pacte Vert en eaux troubles : ambitions et réalités
Présenté en 2019 par la Commission européenne et entériné l’année suivante, le Pacte Vert Européen, ou Green Deal, porte une ambition claire : atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Cet objectif ambitieux s’inscrit dans la continuité des engagements pris lors de l’accord de Paris de 2015. À plus court terme, le Pacte Vert vise une réduction significative des émissions nettes de gaz à effet de serre, avec un objectif de -55% d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990.
Si ce programme a initialement suscité un certain enthousiasme, notamment lors des élections européennes de 2019 marquées par une vague verte, le contexte politique a évolué avec les élections de 2024. La montée en puissance des partis conservateurs a fragilisé la dynamique initiale, ouvrant la voie à des pressions croissantes pour un assouplissement, voire un démantèlement, des mesures environnementales.
La remise en cause des normes écologiques : un mouvement européen
Les critiques à l’égard du Pacte Vert se multiplient à travers le continent. « C’est une question d’équilibre politique au Parlement européen. Il est clair que le Green Deal n’est plus considéré comme une priorité absolue », analyse Olivier Costa, politologue et directeur de recherche au Cevipof.
Sous le premier mandat d’Ursula von der Leyen à la présidence de la Commission européenne, l’Union européenne s’était positionnée en leader mondial de la lutte contre le changement climatique. Cependant, au fil du temps, les préoccupations environnementales ont été reléguées au second plan, au profit des enjeux de compétitivité et de croissance économique.
Compétitivité versus climat : un débat central
L’ancien président du Conseil italien, Mario Draghi, a récemment publié un rapport soulignant le déclin économique de l’Europe face aux États-Unis. Il y plaide pour un retour en force de la compétitivité et une simplification des réglementations européennes jugées trop contraignantes. Une vision qui semble avoir trouvé un écho favorable auprès d’Ursula von der Leyen.
Sous la pression des milieux d’affaires, la Commission européenne envisage ainsi de revoir plusieurs dispositions du Green Deal à travers le plan « boussole pour la compétitivité ». Certains textes emblématiques du pacte, considérés comme inapplicables par les grandes entreprises, pourraient être assouplis, notamment ceux sur :
- La fin des moteurs thermiques en 2035,
- La directive CSRD imposant aux entreprises d’intégrer des données sur la durabilité,
- La lutte contre la déforestation importée,
- Les obligations en matière de recyclage et d’économie circulaire.
Par ailleurs, la directive sur le devoir de vigilance des entreprises européennes de plus de 500 salariés, qui impose des responsabilités en matière de droits humains et environnementaux, pourrait également être reportée ou atténuée.
La neutralité carbone en question : un objectif de plus en plus incertain
Le Green Deal se trouve désormais sous pression, fragilisé par une concurrence internationale exacerbée et des tensions commerciales croissantes avec la Russie, la Chine et les États-Unis. L’éventuel retour d’un ancien dirigeant américain à la Maison-Blanche pourrait aggraver cette dynamique. « Il n’a aucun intérêt pour les enjeux environnementaux et se retire de nombreuses instances internationales, relançant ainsi la course à la compétitivité », rappelle Olivier Costa.
Cette posture inspire les extrêmes droites européennes, qui y voient une justification de leur ligne politique. Parmi les pays les plus virulents contre le Green Deal, l’Italie de Giorgia Meloni et la Hongrie de Viktor Orban se démarquent par leur opposition farouche aux réglementations écologiques européennes.
Un soutien français en demi-teinte : entre pragmatisme et pressions
En France, la position du gouvernement reste plus nuancée. Si l’Hexagone a soutenu le pacte vert, le ministre délégué chargé de l’Europe, Benjamin Haddad, a plaidé pour une simplification et une suspension de certaines directives. « Si nous investissons dans la transition environnementale tout en accompagnant nos entreprises, faisons-le avec pragmatisme et bon sens », a-t-il déclaré sur France Info.
La France subit actuellement un fort « backlash écologique », notamment dans l’industrie automobile et le secteur agricole, où la grogne monte contre les normes européennes jugées trop contraignantes pour la compétitivité des entreprises françaises.
Vers un affaiblissement des taxes carbone : un signal inquiétant
Wopke Hoekstra, commissaire européen en charge du climat, a annoncé jeudi que la Commission européenne envisageait d’exempter 80 % des entreprises de la taxe communautaire sur les émissions de carbone aux frontières de l’UE, prévue pour 2026. Selon lui, seules 20 % des entreprises sont responsables de la majorité des émissions de gaz à effet de serre.
« Actuellement, nous imposons une charge administrative lourde aux entreprises sans réel bénéfice environnemental. Ce n’est pas la solution », a-t-il déclaré.
Cette annonce illustre bien la tendance actuelle : loin d’être renforcées, les réglementations environnementales européennes pourraient être revues à la baisse, compromettant les objectifs de neutralité carbone fixés pour 2050. Derrière le démantèlement progressif du Green Deal, c’est tout l’avenir de la transition écologique européenne qui se joue.